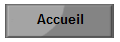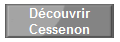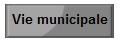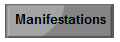| | | |
Le patrimoine
architectural
| |
| | | |
L'Eglise Saint Pierre Saint
Paul
Construite probablement sur un mausolée gallo-romain Ier
ou IIème siècle après J.C., elle ne vit le jour qu'après de multiples tractations.
En effet, dans les premiers temps du christianisme, en 972, l'église
n'était qu'une modeste chapelle. Ce n'est qu'en 1 325 que sa
construction fut achevée. Cet édifice religieux fait partie de l'architecture
gothique méridionale. Très imposant avec ses 20 mètres de haut, 47 mètres de
long, 16 mètres de large, ses murs très épais, ses puissants contreforts, ses
rares ouvertures, il ressemble à une cathédrale. Sa porte est en chêne massif et
son verrou est un gorgerin d'armure.
| |
| | | |
Le sarcophage
Datant de l'époque gallo-romaine, Ier siècle
avant J.C., ce fragment de bas relief d'un sarcophage a été retrouvé lors du
dallage de l'église. De nos jours, on retrouve cette pierre sur le pan de
maison, place du marché : Le Helder. Les inscriptions sont les suivantes :
SVLPICIO A PRESTANTIA A...VITALINIA...KARISSIMA...RVM IPSIVS... SARCOPHAGV...
EXIBERE CVI...RANTE EVSEV... AMANTIS. La scène reproduite sur cette pierre
représente un banquet funéraire, 7 personnes autour de la 8ème allongée dans un
triclinium, salle à manger avec des lits en pente. La tête de l'enfant, bouclée,
est caractéristique de l'école de sculpture arlésienne.
| |
| |
La Font de la Gleizes ou Fontaine du Plô
La source qui jaillit à la Fontaine de l'église est déjà mentionnée
en 1 555. En 1 693, on pave le dessus de la voûte de la fontaine,
on installe un abreuvoir et quelques temps après des lavoirs. La restauration
récente les supprime.
| | | |
| | | |
Le donjon
Debout sur son socle
rocheux, calé à l'arrière du système défensif, le donjon indique l'emplacement
de l'ancienne forteresse. Cette tour, de plan quadrangulaire d'une hauteur
de 15 m et de 6 m de côté, a été construite avec des matériaux locaux. La
partie inférieure plus récente a des baies ogivales. Des gargouilles de type très
simples ornaient les angles. En 1 921 trois cloches baptisées par le
cardinal de Cabrières dans l'église de Cessenon ont été hissées dans le clocher.
La plus grosse cloche pèse 800 kg, elle a été fondue à Tarbes, elle porte les
images du Christ, de la Vierge et des 12 apôtres, de Jeanne d'Arc, ainsi que les
armes du cardinal de Cabrières. Un casque de poilu surmonte l'image du calvaire.
Les 69 noms des poilus morts à la guerre sont gravés sur la cloche. Elle donne
la note "mi". La seconde pèse 550 kg et porte les images du Sacré-Coeur et
Sainte Radegonde. C'est la cloche de la charité, elle donne la note "sol". La
troisième pèse 250 kg, c'est la cloche des petits enfants, elle porte l'image de
la Vierge, elle donne la note "si". Une horloge a été installée au milieu de la
fašade au XVIIème siècle. Le donjon est l'emblème du village, il égrène
inlassablement les heures, carillonne et rythme les bons et les mauvais moments
de la vie.
| |
| | | |
La Chapelle Saint Roch
Cette chapelle, qui s'élève sur l'avenue Raoul Bayou à l'extérieur des
remparts, aurait été fondée au milieu du XVIème siècle par Robert Sicard
dont le nom est gravé sur le bénitier en marbre blanc avec la date 1 547.
Le 27 décembre 1 758, les consuls de Cessenon donnent l'autorisation de
reconstruire l'édicule en le déplašant. Durant le premier quart du XIXème
siècle, un clocheton est installé sur le mur, aujourd'hui remplacé par la croix.
Saint Roch natif de Montpellier sera invoqué contre la peste. La fête locale se
déroule pendant la semaine de la Saint Roch (16
août).
| | | |
| | | | | |
La maison "médiévale"
Mentionnée sur le cadastre de 1 810, elle date
vraisemblablement du XVIIème siècle. Elle a été restaurée avec une certaine
fantaisie. Le colombage est un plaquage maladroit de planches de bois sur une
mašonnerie moderne, seul le rez-de-chaussée a conservé son authenticité ainsi
que l'encorbellement du premier étage et les murs de refend mašonnés jusqu'au
toit. Par son originalité, elle attire l'oeil et elle est devenue une galerie
d'art.
| |
| | | |
La fontaine sucrée
Pourquoi sucrée ? Nul ici ne le sait. L'eau qui coule dans
l'auge depuis le tuyau en fonte est riche en calcaire. Déclarée non potable, elle
est pourtant bue depuis toujours par de nombreux Cessenonais. Son débit, même
en temps de sècheresse, est très important et d'une grande fraîcheur. Sa
construction résulte d'une délibération du conseil municipal en 1 835.
Elle a été restaurée en 1 996. Un auvent a été bâti sur la fašade et les
tuyaux ont été encastrés, une croix du Languedoc en fonte y a été placée. L'une
des portes du Château, Porte de l'Olivet se trouvait à l'emplacement de la
fontaine.
.
| | | |
| | | |
La tuilerie Riche
Elle fut créée en 1 860, par Raymond Cathala. En 1 864, il maria sa
fille à Moïse Riche. De cette union naquit Louis et Victor, qui transfèrent la Tuilerie
de la rue des aires sur le tènement où trône la cheminée qui mesurait à
l'origine 16 mètres. En 1 981, la tuilerie moderne Riches Frères fermait ses
portes après 80 ans d'activité. 100 salariés qui logeaient près du cimetière dans
des logements appelés " les baraques " y travaillaient. La terre provenait
des terriers environnants et des wagonnets apportaient le produit directement
à l'usine. Les baraques furent détruites en 1 960. Vers 1 980
le four de l'usine explosa (2 morts) et 60 familles furent au chômage. Les
bâtiments de cette ancienne usine font partie aujourd'hui du domaine privé et
communal. La partie basse de la cheminée a été
conservée.
| |
| | | |
La Capelette ou la Chapelle Sainte
Anne
A 600 mètres du village sur la D14, se trouvait une
baraque de cantonniers. Par le plus grand des hasards d'une part et par
l'appellation du lieu "Capelette" (petite chapelle) d'autre part, on découvrit
les vestiges d'une ancienne chapelle qui pouvait avoir 12 mètres de long, on
peut penser que cette chapelle était dédiée à la mère de la Vierge Marie puisque
le nom de Sainte Anne concerne aussi ce tènement.
| | | |
| | | | | |
Les ponts
Le pont dans le village
On parle beaucoup du pont dans l'histoire. Au Moyen Age, au
XIIème siècle, les consuls regrettent que le pont détruit ne soit pas
reconstruit. Jusqu'en 1 866, un bac sert à transporter passants et animaux.
Grâce à l'ingénieur A. Boulland, le 24 mars 1 866 un pont suspendu à péage est
ouvert au public ; son tablier est en bois. En 1 924, il est remplacé par un
pont métallique avec piliers. Hélas en mars 1 930, une crue emporte le pont. En
1 931, un nouveau pont suspendu métallique est construit (113 mètres de long
pour une largeur de 6 mètres 80).
Les ponts extra
muros
- 1 927 : construction du pont sur le Vernazobres, route de Lugné.
- 1
894 : construction du pont à Réals. Il possède 5 voûtes de 13 mètres reliées
par un arc métallique de 50 mètres.
| |
| | |
|
|